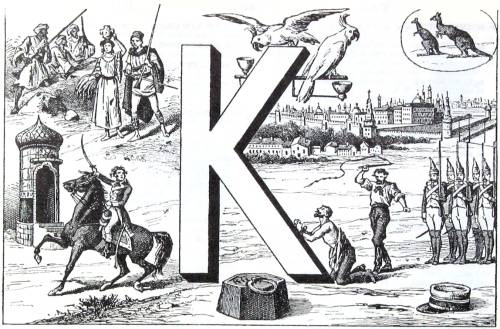La fréquence de cette lettre est de 0,05 %, elle se situe au 25e rang.
Elle provient du phénicien kaf (kaph) qui signifiait « paume de la main ». La forme orientée à gauche peut représenter une main, mais c'est surtout visible avec les doigts réunis comme en protosinaïque. Ce serait un moyen mnémotechnique comme pour la lettre précédente yod (iota, i) figurant une main avec des doigts étendus. D'autres noms (ain ou omicron l'œil, ros ou rhô la tête, pé ou pi ou la bouche) renvoient à des parties du corps.
La lettre s'inverse en grec, mais sa forme demeure quasiment identique avec toujours une jambe et deux demi-barres obliques que ce soit en étrusque et en latin. Le kappa valait pour 20 en grec. Les Romainsl'ont peu utilisé comme nombre. Il valait alors 250 et surmonté d'une barre 250 000.
Les Romains ont peu utilisé la lettre K sauf dans des abréviations comme K. pour Caeso, Kal. pour kalendae. Quelques noms propres ont été aussi écrits avec cette lettre Karthago, Kasa, Kana. Il s'agit d'un usage plus grec. Elle a été jugée inutile par Priscien. Ensuite, la lettre K. a été l'abréviation pour Constantin et pour Charles (Karolus).
Elle est fort employée en ancien français en concurrence avec la graphie qu dans des mots latins. Toutefois, on l'élimine à la Renaissance. La graphie ch possédait une double valeur, l'une héritée du latin pour transcrire les mots grecs comprenant un khi, par exemple cholere (de kholê), l'autre héritée de l'ancien français pour noter le /k/ palatalisé par exemple cher (de caru). Malheureusement, la graphie simplifiée avec c sera préférée devant a et o (caméléon, mélancolie), avec ch conservée dans les nouveaux emprunts (archétype) mais avec des valeurs héritées de la lecture ancienne (archévêque). Le recours au k n'est pas jugé utile alors que selon Duclos « Le K est la lettre dont nous faisons le moins et dont nous devrions faire le plus d'usage, attendu qu'il n'a jamais d'emploi vicieux. »
Le premier mot nouveau à venir en français avec un k est kiosque, tiré du turc mais passé par l'italien, d'où une première graphie chiosque (1606) conforme aux conventions italiennes, mais ambiguë en français. Le mot sera refait à la fin du XVIIe s.
Le dictionnaire de Furetière (1694) ne comprend que cinq mots en K : kalendes (avec renvoi à calendes), kali (que l'on écrira ensuite alcali), karabé (qui deviendra la carabe), kinkinna (avec renvoi à quinquinna) et kyrielle, mot grec. Le dictionnaire de l'Académie au même moment ne connaît que ce dernier. Il indique : On s'en servoit autrefois en quelques mots, comme, Kalendes. Kalendrier.
On s'en sert encore en ce mot Kyrielle, & en quelques noms propres pris des Langues estrangeres, comme, Stockolm, York, &c.
Il faut noter que des noms anciens ont été francisés comme Københaven devenu Copenhague sur le modèle normand de La Hague.
La situation ne change vraiment qu'en 1762 avec l'entrée de 21 autres mots dans le dictionnaire de l'Académie. Ce sont des termes d'origine grecque (kyste), chinois (kaolin), russe (kremlin), arabe (kermès), mongole (khan). Cela témoigne de deux changements profonds : les scientifiques calquent désormais le grec et non plus son intermédiaire latin seulement ; les relations de voyage apportent une foule de mots exotiques dans les orthographes les plus diverses. Le k qui avait été rejeté comme lettre étrangère – il ne figure pas dans certains alphabets – revient à cause de son étrangeté. Les mots allemands au XIXe s. et anglais au XXe s. vont contribuer à le renforcer de manière exponentielle.
La capitale K est l'abréviation de l'unité de mesure Kelvin, la forme °K est ancienne. La minuscule k sert d'abréviation légale au kilo en composition : kg ou kilogramme(s), km ou kilomètre(s). La marque K sur des monnaies indiquait une frappe à Bordeaux. Dans B. K. elle renvoie à Koch (bacille de).
Revenir au cabinet de curiosités
Revenir au sommaire